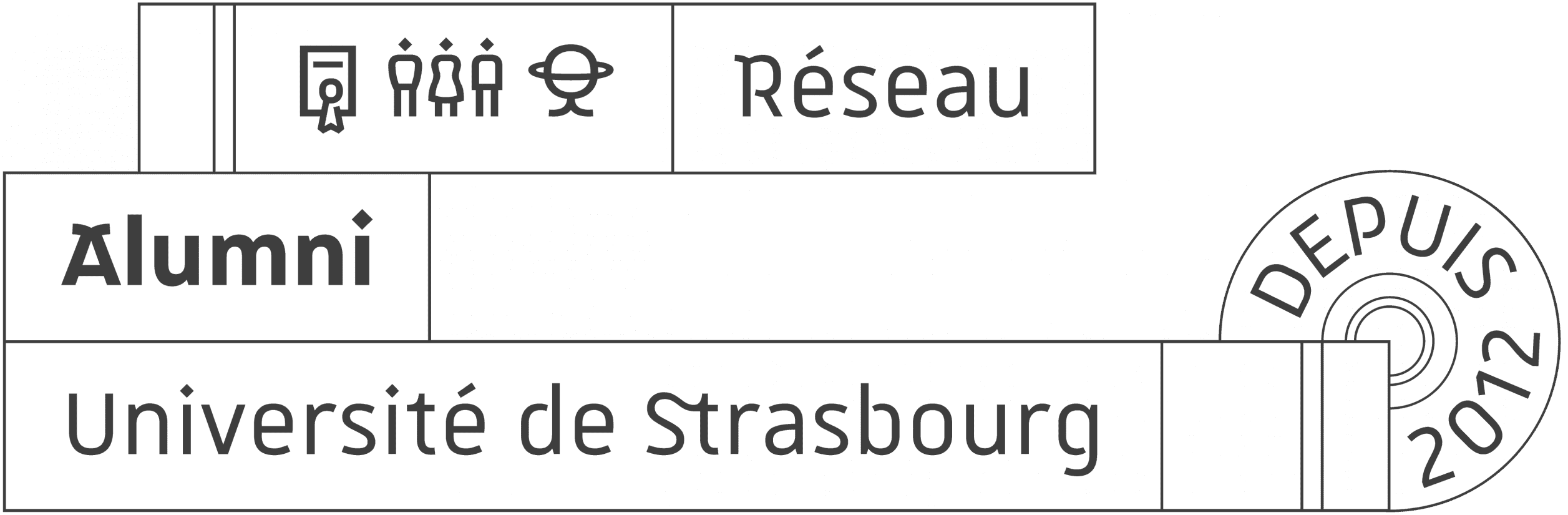Alioune Bah, docteur en Philosophie à l'Université de Strasbourg, est l'auteur du Pater Noster et la Fatiha: deux textes, une même prière, Paris, L'Harmattan, 2015. Il présente Contre toute attente. Autour de Gérard Bensussan, Paris, Classiques Garnier, 2021.
« L’animal politique », c’est la personnalité.
« C’est comme défi que l’abstraction de la volonté libre prend figure ».
Ces morceaux de phrases extraits chez Franz Rosenzweig de L’Etoile de la rédemption me paraissent signifier l’inébranlable personnalité philosophique du professeur Gérard Bensussan, « la volonté de défi » favorisée chez lui par les événements de sa propre existence. Le philosophe strasbourgeois approche la chose philosophique par le prisme exigeant d’une compréhension de ce qui pousse l’agir humain dans la société. Sa pensée inscrit donc une orientation pratique qui se nourrit à plusieurs sources : philosophie allemande, pensée juive, philosophie française, littérature européenne, sources qu’elle féconde à son tour par son génie.
En effet, c’est à cette pensée que ce très beau livre, Contre toute attente, publié au premier semestre de cette année, rend hommage. Autour de Gérard Bensussan, comme l’indique le sous-titre, il s’agit d’un ouvrage qui rassemble les actes d’un colloque tenu à Strasbourg en 2019, pour saluer l’œuvre du philosophe strasbourgeois, son enseignement et sa recherche. Le livre est constitutivement articulé autour de deux ensembles : le premier renvoie aux textes sur la pensée du professeur Gérard Bensussan, sur les lignes qu’elle dessine notamment sur des questions qui charrient toujours la politique, l’éthique, la philosophie juive, la langue, le savoir philosophique lui-même. Les questions abordées sont toujours actuelles et notent une constellation de sujets et de thèmes centraux de la philosophie. Les articles témoignent avec précision de la richesse de sa pensée et de son apport inestimable à la compréhension des enjeux subsumés dans les grandes philosophies.
La seconde partie, intitulée Ostalgérie, revient sur un ensemble d'entretiens réalisés il y a plus de dix ans avec deux doctorants, devenus depuis des collègues du philosophe. Andréa Potesta et Aïcha Liviana Messina entretiennent un dialogue rigoureux avec le "Maître", à la manière des dialogues platoniciens, où l'entrain du concept conduit à l'épuiser en son cœur vibrant, et ceci sans aucune complaisance. La richesse biographique de cette seconde partie donne des éléments de contexte qui favorisent la compréhension de la pensée du professeur Gérard Bensussan, de l'originalité qu'elle porte et de son ouverture sur l'universel, un universel qui congédie tout conformisme dans la pensée. Éprouver le concept, l'épuiser, telle est l'exigence des entretiens structurés autour de l'enfance et la jeunesse du philosophe, son engagement au sein du parti communiste français lors de la grande révolution sociale de Mai 1968, son exil allemand, les tracasseries politico-administratives de cette période qui coïncide avec son statut de jeune père. De retour en France, après une amnistie présidentielle, le philosophe continue sa recherche, traduit Schelling, étudie les philosophes juifs et introduit le judaïsme en philosophie à travers des questions remarquablement analysées. L'engagement philosophique du professeur Gérard Bensussan est un continuum de son engagement politique. Dans l'un comme dans l'autre, sa posture est marquée par un esprit de justice: rendre justice aux penseurs qui l'ont précédé à travers une lecture juste et objective, qui les relève des approximations faites sur leurs œuvres. C'est le cas de Schelling, de Marx, de Rosenzweig, de Benjamin, de Moses Hess, de Derrida, Levinas, de Nietzsche, etc. Comment penser la richesse des idées introduites en philosophie par le professeur Gérard Bensussan sans tomber dans la redite et la paraphrase ? Comment mettre en évidence l’originalité et la force des démonstrations qui portent son discours philosophique sur le temps, l’amour, la fécondité des langues, la politique, l’éthique, l’idéologie ? La densité du réseau conceptuel qu’il mobilise dans son travail peut être, dans le cadre d’une synthèse de cet ouvrage, ramenée à trois grands ensembles : l’engagement politique en contexte totalitaire, le rythme du temps interruptif pensé à partir du messianisme juif et enfin l’expérience éthique à travers la question de l’altérité (individuelle et communautaire) en relation avec le/la politique.
- L’engagement politique en contexte totalitaire
Le parcours personnel du professeur Gérard Bensussan, tel qu’il est livré dans la seconde partie de l’ouvrage dans les échanges avec Aïcha Liviana Messina et Andréa Potestà, et à quoi le texte de François-David Sebbah fait écho, apporte des éléments structurants pour saisir les mouvements de sa pensée. On y trouve la question de la violence, celle de la grammaire révolutionnaire et enfin l’expérience du totalitarisme qui en symbolise l’échec.
1.1. Violences politiques : arrachement à la terre natale et double exil
Un point biographique très intéressant consiste à rappeler que le professeur Gérard Bensussan est né en Algérie encore colonie française. Juif algérien, il a vécu dans un climat de mixité ethnique et religieuse. Ses sept premières années sont marquées par cette vie innocente et insouciante, faite de jeux, d’histoires familiales qui se racontent de générations à générations. C’est une enfance heureuse, comme on aimerait qu’elle dure pour nos enfants, tous les enfants. Mais, elle sera brisée par un événement que le philosophe raconte lui-même en ces termes : « je suis à Alger, je devais avoir 8 ou 9 ans, je descends avec ma mère faire des courses, et je vois un homme courir dans la rue et abattre à bout portant un autre homme » (p.167). Cet événement d’une violence extrême en soi, l’est davantage pour une âme précoce. Elle constituera un élément déterminant dans la formation de l’adolescent qui connaitra plusieurs autres événements tragiques. A 14 ans, c’est le grand exil, le rapatriement des juifs d’Algérie vers la France : arrachement douloureux à la terre natale, déracinement, en quelque sorte : « violence de l’arrachement au pays natal, du départ forcé, de l’abandon, du risque, de la menace et de l’exil » (p.158). Mais il y a aussi l’espérance de trouver en France la liberté, la possibilité de s’épanouir loin de cette violence que connaît l’Algérie des mouvements de libération, des factions clandestines aussi bien françaises qu’algériennes. L’arrachement est également éloignement des lieux, des paysages, des personnes qu’il a connues et côtoyées, de l’histoire familiale inscrite dans une histoire plus vaste, celle d’un territoire avec ses propres manières d’être, avec sa singularité. D’ailleurs, cette idée de singularité, on le verra aura une empreinte forte sur la dimension intersubjective des rapports que les individus ont à construire et à vivre sur un plan horizontal, en marge de toute action de l’Etat ou de ses institutions.
En France, l’adolescent de Mascara et d’Alger accède à la majorité, s’oriente en classe de philosophie. C’est la période de la révolution sociale de Mai 1968. Le communisme et les revendications portées socialement en faisaient un moment unique. La révolution pensée théoriquement par Marx avec toutes ses exigences était à porter de main. Il convenait de renverser les systèmes de dominations économiques et politiques, de transformer radicalement les formes de l’action et de la décision politique. Tel était l’idéal auquel adhérait le jeune étudiant en philosophie. L’idéal de Marx était précis dans son énoncé, mais l’action allait-elle suivre ? L’engagement du jeune Bensussan sera effectif et son activisme concret. La suite des événements le conduira à partir de France, à « fuir ». Ce sera de nouveau l’exil. Un exil dans l’exil. Il se réfugiera en Allemagne de l’Est, à Berlin. Cette biographique, ou ce bio-philosophème nomme, pour François-David Sebbah, l’impossible : « Impossible. C’est le mot qui m’arrive pour désigner la philosophie vécue et pratiquée par Gérard Bensussan – la philosophie face à l’impossible, dès lors elle-même impossible, et pour cette raison même, non pas empêchement ou extinction, mais relance indéfinie de sa propre exigence et de son propre mouvement » (p.15). Cet impossible se présente sous deux figures irréductibles l’une à l’autre, mais cohabitant tout de même en la personnalité du philosophe strasbourgeois : « l’impossibilité du propre et du pur, de la coïncidence à soi. Impossibilité tant de l’identité à soi, que des identités d’assignation collective ». En un mot, ni Juif, ni Français, ni Algérien, ni Maghrébin. Il est tout cela à la fois, et aucun en particulier.
Mais la révolution offre également un déploiement d’une double violence des acteurs en présence : le militant et l’Etat. Dans ce face-à-face, François-David Sebbah souligne que la « violence subie, violence produite : contre la force de l’Etat, le militant reste tout contre, c’est-à-dire encore dans l’immanence de la violence qui germe et se referme. Flic ou militant violent, d’un certain point de vue la différence de l’un à l’autre est bien mince : partage de la violence » (p.17).
1.2. La grammaire révolutionnaire.
Il est intéressant de revenir à la période de Mai 1968 et à la façon dont le philosophe l’exprime : il était « marqué par le maoïsme, c’est-à-dire par une position politique qui combattait le « révisionnisme » ou le « capitalisme d’Etat » soviétiques ». Cette position tranche radicalement avec le rêve utopique d’une société sans classes, d’un nivellement par le haut ou par le bas, égalitaire somme toute, dans toutes les sphères. Déjà, la maturité avec laquelle le jeune philosophe saisissait les enjeux de son monde dominé par le face à face idéologique entre les grandes puissances économiques et militaires de la seconde guerre montre, outre la conscience de son engagement, l’idéal de justice qui motive son action. Il y va de l’adéquation de toute politique avec la demande sociale, de la manière juste d’aborder les questions prioritaires de droits individuels et collectifs. Pour le philosophe, la grammaire même de la révolution s’articule à quelque chose qui l’excède : « la révolution demande plus, infiniment plus et autrement que le « dû ». Elle demande l’ouverture des possibles, non le dû ; elle demande la liberté, non la loi » (p.180). La liberté est donc au cœur du processus révolutionnaire, elle implique une émancipation de toutes les formes d’oppression, d’ostracisme et négation des potentiels inouïs de l’humain. La liberté comme affranchissement est également perçue en tant que processus de déploiement, de réalisation, du devenir soi. Rosenzweig accorde d’excellentes pages à cette question du devenir soi comme préalable à une extériorisation pour autrui des valeurs humaines fondamentales.
La révolution, sans être utopique, au sens où l’entend le professeur Gérard Bensussan, et on pourrait dire au sens marxien premier, non en ce sens très répandu dans les commentaires de Marx, consiste à donner la possibilité à quelque chose de se réaliser, d’arriver au jour au-dedans même d’une situation politique. Cette « ouverture du dedans » ou encore cette « déclosion » sont ce qui rendent possible la transformation d’une situation, la quête d’une positivité qui ne serait plus abstraction ou utopie, mais devenir réel. La révolution ainsi en tant qu’événement, dans l’attente même de réaliser sa grammaire, se voulait disruptive, c’est-à-dire, faire irruption dans un temps et en bouleverser la logique. Elle engageait, à titre d’événement, au « différemment temporel », comme l’écrit Andréa Potestà.
L’engagement du philosophe est également remarquable auprès de la résistance vietnamienne. Il portait le même nom de Liberté. La chose avait du sens. Elle le raccrochait à l’idéal de transformation sociale à partir de l’action des forces endogènes et, sans combler un vide laissé béant par la situation algérienne, rendait possible de continuer la cohérence du questionnement politique, de la liberté comme finalité de la politique, et de la justice comme finalité même de l’agir libre. Toutefois, le désir de changement caractérisé par la révolution allait être confronté à « la violence dont les Etats sont capables au nom de la fraternité » (p.23).
1.3. L’expérience totalitaire
La « défaite de l’expérience » révolutionnaire souligne un « encauchemardement » du monde. Le communisme maoïste pressenti comme un renouvellement humaniste du modèle soviétique s'est rapidement transformé en machine de terreur. Partout les communismes sèment la terreur: en Chine sous Mao, en Allemagne de l'Est avec un système bureaucratique et son appendice policier très répressif. Le jeune philosophe en fera les frais. En Allemagne, l’expérience totalitaire pour le jeune exilé se fait « violence ensuite de la vie mutilée en « totalitarisme », violence sourde, constante, permanente, qui contraint les sujets à tenir deux discours : un discours privé et un discours public, une parole pour soi et pour chez soi et une autre pour la scène sociale » (p.158). Malgré tout, son expulsion interviendra, « expulsion froide obéissant à la simple exécution d’une décision opaque et irrévocable » (p.160). Le souvenir de cette expulsion est vivace, malgré l’oubli, car elle « fut d’une incontestable violence, violence du non-sens, du silence, d’une condamnation sans jugement et sans attendus, sans cadavres » (p.167). L’absence de justice dans les systèmes totalitaires, déjà évoquée par Hannah Arendt, trouve ici également une illustration évidente. La logique bureaucratique et administrative, et surtout l’obéissance aveugle qui triomphe en système totalitaire de l’exercice rationnel exposent à la violence la plus abjecte, la plus insignifiante. On observe la même déclinaison dans plusieurs pays alignés à la faveur de la guerre froide du côté de l'URSS. Entre l'idéal et le faire s'installe une distorsion radicale. C'est toute une espérance qui s'évanouit. Mai 1968 porte ainsi l'évanescence de la révolution, pensée par Marx comme devant tirer sa force des réalisations positives et humanistes qu'elle consentirait à mettre en place de façon durable. C'est en tirant sa langue de l'avenir que toute révolution fait vivre in concreto l'espérance, non chimérique, mais une espérance de renouveau et de progrès telle que Marx le thématise. Soulignant l’écart entre désir et politique au moment de Mai 68, on peut lire « si au joli mois de mai a succédé l’immense déception de la rentrée de septembre, c’est parce que ce moment fusionnel désir-politique était en train de se défaire, de retrouver ses morceaux séparés » (p.227).
D'Algérie, de France, d’Allemagne et du Vietnam, cet idéal de justice, de solidarité et de liberté s'est nourri dans une activité philosophique intense, car la continuation de l'engagement politique pouvait être réalisée dans la réflexion et l'action individuelles, dans un registre totalement différent du parti. Ainsi, la déception de la ferveur portée lors de la révolution, les idéaux du jeune philosophe prendront la forme d'une pensée rigoureuse et émancipatrice, une pensée de la/ du politique, dans laquelle précisément l’éthique et l’idée de justice ne sont jamais marginalisées.
2. Au rythme du temps : interruption et imprévisibilité
Le processus de L’introduction du judaïsme en philosophie n’est pas un moment d’une reconnaissance polie à un ensemble de penseurs tels que Moses Hess, Benjamin, Rosenzweig ou encore Levinas et Derrida pour la qualité exceptionnelle de leur contribution à la philosophie contemporaine. A travers le messianisme qui rétablit la noblesse du temps tel qu’il est pensé dans le judaïsme, se trouvent examinés le caractère interruptif du temps, son œuvre dans ce qui est « Ostalgérie », c’est-à-dire la dialectique entre la nostalgie et l’oubli, deux notions placé sous la juridiction du temps, et qui appellent un processus de remémoration.
2.1. Le temps comme interruption et infinition
Si le constat est évident par les différents titres consacrés à la philosophie juive, comme le rappelle bien Alain David (pp.59-71), c’est aussi le lieu de l’affirmation de concepts forts, notamment celui de « messianisme » en philosophie qui vient impulser une autre manière d’envisager le temps[1]. Le messianisme comme philosophie du temps entend résoudre une confusion qui traverse toute la philosophie moderne en mettant en évidence le caractère imprévisible et interruptif du temps, son caractère disruptif comme on dit aujourd’hui. Comment procède le professeur Gérard Bensussan, et comment cette procédure réapparait dans ce livre ?
Dans son texte sur la Nostalgie saturnienne, Andréa Potestà évoque l’incidence du temps dans la concaténation des événements, dans la rythmique traditionnellement admise en Passé, Présent et Avenir. Si la nostalgie dénote ce qui n'est plus dans le temps présent, ce dont le passé fait revivre la présence en notre conscience, il montre comment le Professeur Gérard Bensussan démontre que la nostalgie saturnienne est cette incapacité du temps d'être une succession du passé, du présent et de l'avenir.
Dans cette perspective le bouleversement introduit dans la question du temps indique que la nostalgie saturnienne pense le temps passé non comme une perte mais comme la possibilité offerte au présent de se renouveler et à l’avenir d’advenir. Il s’agit de saisir dans le passé irrémédiablement passé les points qui permettent de penser le présent dans son instantanéité et d’envisager l’avenir. Il y a donc un appui sur le passé, non dans l’idéal d’une reproduction identique à lui-même, mais dans la possibilité d’anticiper ce qui doit arriver. Il y a une sorte de brisure du déterminisme dans le temps passé qui s’annonce dans la nostalgie saturnienne. Le professeur Gérard Bensussan écrit à ce propos : « le temps est l’endurance de l’Infini par le fini qui l’affecte, la façon diachronique d’une patience dont l’humain fait l’épreuve et où se défait tout contenu contenable[2]». Le passé est donc inscrit dans cet infini qui ne cesse de s’actualiser, de devenir un présent qui est déjà en train de passer. De là s’inscrit la question de l’instant qui implique une impossible coïncidence avec la décision. Ainsi, écrit Andréa Potestà, « l’instant immédiat de la décision n’est qu’une projection idéalisée, utopique, car le présent est toujours déjà habité par la tension de l’indécidable » (p.32).
Sur l’instant, Orietta Ombrosi revisite l’idée de commencement comme commencement par le temps. Elle expose la structure du temps chez le professeur Gérard Bensussan comme une « promesse » (p.35). L’impatiente patience du temps nomme le procès interruptif logé au cœur de son projet, dans lequel précisément « l’instant est toujours d’un acte, la discontinuité de ce qui s’actualise selon une sommation inattendue[3]». Orietta Ombrosi recherche la généalogie de cette idée « d’instantanéité de l’instant » en mobilisant les pensées de Rosenzweig et de Benjamin. Pour le premier, notamment dans L’étoile de la rédemption, un accent particulier est mis sur le rapport de l’instant à l’éternité. Rosenzweig écrit : « l’instant demeure intrinsèquement instant ; il passe. Mais tant qu’il n’est pas passé, il est en soi une petite éternité[4]». Pour Benjamin, il y a nécessité d’opérer une distinction entre le temps historique
– qui est le temps vécu – et le temps de la mécanique. Si le temps mécanique est vide et dépourvu de contenu substantiel, le temps historique, temps humain, est riche en contenu, en expériences humaines et donc en vécu. Ainsi, elle retrouve dans cette généalogie un lien fécond qui part de Rosenzweig au professeur Gérard Bensussan en passant par Benjamin qui se construit sur « la promesse de l’instant, du maintenant, de l’heure, dans toutes leurs nuances, force en tout cas capable de suspendre et interrompre le temps » (p.43). Dès lors, cette suspension du temps laisse ouverte la perspective d’une venue, de ce quelque chose qui doit arriver et inscrit ainsi le temps de l’attente, une attente qui se fait impatience.
2.2. Ostalgérie: dialectique entre nostalgie et oubli
Ostalgérie nomme la conjonction des lieux d’expérience de vie singulière du philosophe que sont l’Algérie, la terre natale et l’Allemagne, la terre de l’exil du militant communiste et de l’expérience totalitaire. Elle pointe vers la dialectique du passé et du présent en référence non au temps, mais aux lieux géographiques, aux topos inscrits dans l’histoire individuelle du jeune philosophe et militant. Un passé fait d'événements difficiles dont la remémoration exacte est impossible, mais un passé qui n'arrête pas d'être présent, de hanter le présent, comme l'aurait dit Derrida. Ce passé n'agit pas comme un spectre, il ne projette pas sa propre reproductibilité, mais fait signe et signale du même coup vers quelque chose d'altéré, de définitivement perdu. C'est cette perte, abyssale parfois, du fond de pensées et d'événements qu'il convient d'inscrire dans l'histoire de la pensée pour la penser non sur le ton d'une critique de la pensée disparue, mais comme le savoir d'un non savoir qui permet tout de même à un certain savoir, fragmentaire certes, de s'établir. Ostalgérie libère ainsi l'histoire dans l'Histoire, particularise le chemin de vie - on pourrait aussi dire le chemin de croix - d'une génération avec incursions symboliques, singularisantes qui marquent ce qui a été le destin individuel. En invoquant le destin, il ne s'agit guère de ressasser un discours théologique de l'implacable duquel on ne peut point s'arracher. Il ne s'agit pas non plus d'un déterminisme, un destin à la turque comme le dirait Leibniz. Le rôle destinal, si l'on peut parler ainsi, est l'impossible réappropriation, l’impossible anticipation de ce passé en son passé. Le surgissement des traces de ce passé, leur manifestation dans le présent se fait tâche.
Ostalgérie apparaît ainsi dans le récit du professeur Gérard Bensussan comme cette perte dont la conscience est consciente de ce qu'elle n'a plus, de ce qu'elle ne peut recouvrer qu'à endurer le non-sens de ce qui se présente à elle dans le présent. Ostalgérie, est donc politique de la mémoire, d'une mémoire en perte de repères propres qui, dans les linéaments de sa trajectoire se découvre dans une incohérence intenable, une inadéquation à soi. L'histoire en effaçant les traces, en traçant des traces sur des traces, rend irréel ce qui a été véritablement, ce qui dans les lieux et dans la pensée et donc dans l'histoire a été vécu et partagé. La suscitation du passé dans le présent dont Ostalgérie est une tentative témoigne aussi de la singularité signifiante de ce passé, de son manque et de sa richesse, toute chose qui en fait un objet de mémoire. Cette mémoire n'est pas non signifiance. Elle résiste à l'oubli et nous apprend que la philosophie est aussi retour mémoriel sur le passé, innovation conceptuelle et reconnaissance d'une identité unique en son genre, et multiple en la multiplicité des lieux qui la constituent. Enfin, Ostalgérie rappelle que l’intensité du souvenir des lieux est faible et souvent ne correspond pas ou plus à la réalité vécue. Il y a la mémoire qui re-constitue, re-trace ce qui a été ces lieux, ce qui a été en ces lieux et qui n’est plus face à la nouveauté advenue de ces lieux, de ces changements architecturaux, urbanistiques. Il y a une non coïncidence entre ce qui a été et ce que produit la mémoire. Mémoire, souvenir et oubli sont donc au cœur du processus ostalgérique, et nomment un enrayement de la mémoire et non un travail de sélectivité. Enfin, elle met en évidence l’évanescence de la mémoire des lieux.
Au-delà de la richesse du concept « Ostalgérie », le professeur Bensussan retrace dans le temps, et précisément la période contemporaine, l’apport des philosophes juifs au rayonnement de la pensée occidentale. Inscrit dans la temporalité qui lui est propre, ce moment philosophique constitue un geste singulier par où se reconnait l’originalité de la philosophie du professeur Gérard Bensussan. Comme l’imprévisibilité du temps ou son imprédictibilité, l’introduction du judaïsme en philosophie à l’époque contemporaine est un signe des bouleversements d’un messianisme qui ne s’accorde pas avec la linéarité du temps, mais l’envisage dans ses promesses multiples qu’il convient alors d’examiner.
2.3. Philosopher en judaïsme : le geste de Bensussan
L'introduction du judaïsme dans la philosophie ne va pas de soi. Outre le réquisit religieux, il y a un rejet caractéristique du judaïsme dans la philosophie allemande dont les figures expressives sont Hegel et Heidegger. On pourrait également trouver chez Kant, notamment dans la relation à Mendelssohn, ce rejet du judaïsme. Le geste de Bensussan vise à décloisonner la philosophie, à la sortir des relents d'européocentrisme qui la portent depuis Hegel. Si la philosophie peut s'entendre en philosophie allemande, grecque, française, donc en termes de philosophie nationale, peut-on dénier à la pensée juive de porter à l'abstraction des sujets qui ont une universalité avérée? On retrouve ce même geste d'ouverture et de reconnexion de la philosophie et de la religion chez le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne.
La force de l'analyse du professeur Gérard Bensussan est d'avoir montré et démontré que l'élément religieux, pas son dogme, mais ses enseignements éthiques et spirituels peuvent-être élevés au statut philosophique. Alain David recense cette force de développement conceptuel dans le cheminement du professeur Gérard Bensussan et apprécie son geste philosophique. Si l'élément philosophique s'universalise dans l'abstraction du concept, il trouve son véhicule dans la langue. L’hébreu, langue sacrée, qui n’est pas livrée dans la quotidienneté, se ploie ainsi à cette exigence, porte et est transporte dans le discours oral les évolutions de sens auxquelles la lettre elle-même se dispose. Catherine Chalier note cette aventure de l'hébreu, et de la possibilité qu'elle offre de philosopher autrement, toujours dans l'entrain du concept. L'hébreu, comme véhicule de la philosophie juive, permet de penser le judaïsme au-delà du penser purement théologique. Parce qu'il peut se prêter à la traductibilité, l’hébreu pourrait offrir des possibilités de dessiner de nouvelles sources d'émergence du sens souvent sédimentées dans la lettre. Ainsi, en affranchissant de la servitude à la lettre, l’hébreu pourrait aider la philosophie à se dire et de se lire dans une « langue vivante », comme le rappelle Catherine Chalier, une « langue où on se sent bien chez soi ». Mais se pose la question du caractère empirique d’une langue elle-même orientée à dire d’abord le sacré, réserve et inquiétude présentes chez Scholem et chez Rosenzweig. Pour Catherine Chalier, cette inquiétude n’est pas un obstacle puisque l’exemple d’Aharon Appefeld montre la possibilité d’apprendre la langue moderne avant d’accéder à l’originale, de pouvoir déchiffrer et faire connaître les enseignements éthiques et spirituels sans affecter le caractère sacré de la langue.
Le procès de la traductibilité qui prend forme dans la pensée juive, et dont la pensée du professeur Gérard Bensussan exprime le sens et les difficultés, invite à sortir de « l'hégémonie d'une autre langue », selon l’expression de Catherine Chalier. S’y trouve exprimée la possibilité créative de toute langue, de conceptualiser le connu et l’inconnu, le visible et l’invisible et d’en préciser le sens. Cette opération de don de sens n’est pas l’exclusive du grec, comme il en ressort des textes d’Alain David et Catherine Chalier sur l’œuvre du natif de Mascara. Pour l’un comme pour l’autre, l’hébreu comme langue philosophique est exigence de sens, tels qu’on peut le voir dans les œuvres de Mendelssohn et de Rosenzweig.
Il y a également un autre rapport à la langue qu'il importe de reconsidérer: c'est la possibilité de dire Dieu, l'amour pour Dieu, ou du moins pour en reconnaître les traces. Langue liturgique, l’hébreu ouvre également à l'éthique de la responsabilité. Pour le professeur Gérard Bensussan, cette éthique implique un processus d'expulsion de soi. Elle fait signe vers une démarche spirituelle où l'on fait place en soi à l'altérité du divin, altérité qui se vit dans la relation avec autrui, tous les autres dans leur différence. La philosophie n'est donc pas figée dans des catégories et des formes qui seraient à dogmatiser. Le philosopher en judaïsme comme en islam ouvre ainsi une nouvelle perspective au philosopher, surtout dans notre actualité où le fait religieux est au cœur du discours politique. Dans cette perspective, l’éthique prend une dimension essentielle chez le Professeur Gérard Bensussan, comme elle l’est chez Levinas.
3. L’exigence éthique
L’éthique commande l’engagement politique et philosophique du professeur Gérard Bensussan. Elle est en projet dans sa pensée et la théorie de l’amour l’exprime. La réflexion qu’il engage, notamment dans Les deux morales, confirme cette quête éthique. Elle donne sens au messianisme qui est aussi action dans le monde, agir déterminé, rupture, empêchement et réalisation. La portée de ce messianisme au cœur du projet philosophique du professeur strasbourgeois ne se comprend précisément que par le but qu’elle vise en dernier ressort. Ainsi ces textes interrogent l’éthique en projet dans sa pensée, la rencontre avec l’éthique de Levinas et enfin la traduction de l’éthique en politique ou ce qui revient, la conversion éthique de la politique.
3.1. L’éthique en projet
Le messianisme, écrit François-David Sebbah, « de multiples façons au cœur du travail de Gérard Bensussan, est la figure qui s’impose, certes parmi d’autres, mais de manière exemplaire » (p.18). Il en retient deux aspects qui pointent solidairement vers la réalisation d’une action concrète, action que doit réaliser le messie, c’est-à-dire tout homme placé dans une relation subjective où il est question d’être présent à l’autre, dans sa différence irréductible, et de répondre de lui. L’idée messianique impliquée dans l’agir est de ne pas attendre la réalisation de la promesse que ce qui doit arriver arrivera, mais de l’anticiper en son caractère imprédictible. S’il n’est pas question de promesse, et encore moins d’une promesse eschatologique dans la fatalité de l’annonce de sa réalisation, il s’agit d’abord d’interpeler à un agir qui rompt avec la passivité.
Le professeur Gérard Bensussan prend appui dans son projet sur la démarche kantienne. « L’éthique subjective de Kant, écrit-il, est la métaphysique d’un monde coupé de Dieu. Mais, à la différence de l’hégélianisme, elle maintient dans la conscience l’idée selon laquelle notre destination dépasse ce monde-ci. Et c’est le temps (de la destination, de l’espacement du concept et de l’être-là) qui donne sens à ce dépassement ou à cette vocation. C’est certainement à ce titre que le messianisme peut tenter de trouver appui chez Kant. C’est pour cette même raison qu’il n’est pas inconsidéré de solliciter l’un des plus grands philosophes de la finitude pour aborder l’idée d’un espoir qui irait au-delà de l’être[5]». Autrement dit, Kant formule les conditions de possibilité du déploiement de la pensée messianique, conditions nécessaires à la compréhension de l’exigence que l’action est nécessaire et ne peut nullement être différée dès lors que la situation l’impose. C’est dans la morale de l’action kantienne, ici et maintenant, que le messianisme recouvre la pleine illustration de sa possibilité, sa réalisation politique.
En marge du respect qui est au cœur de la relation subjective chez Kant, le professeur Gérard Bensussan convoque la notion d’amour, c’est-à-dire « amour comme livraison inconditionnelle de soi à la singularité de l’autre » (p.20). C’est La vérité de l’amour, écrit Aïcha Liviana Messina qui porte l’élan de détotalisation dans la démarche du philosophe strasbourgeois. Si « l’amour décrit une nouvelle intrigue dans la pensée de Gérard Bensussan », c’est parce que, précise-t-elle « l’amour serait ce qui viendrait déranger, à son tour, l’éthique » (p.75). L’amour comme l’éthique seraient deux formes de détotalisation dans le discours politique comme dans son correspondant religieux, notamment sur l’idée de l’amour de l’humanité. De là, elle retrouve « l’homologie structurale » entre les deux, entre l’éthique et l’amour. Par-là, elle entend l'intrigue nouée entre le politique, l'éthique et l'amour qui viendrait déranger l'éthique au même titre que celle-ci bouscule la politique, la fait se réaliser, s'incarner dans ce qu'elle devrait être, loin des discours rhétoriques, souvent populistes et démagogiques. Cette exigence de la pensée de l'amour chez Bensussan consiste dans le fait que l'amour nous extrait et nous soustrait des modes de totalisations souvent convenues, pour mettre en évidence la force de la relation subjective, du face-à-face, de la communion des corps qui sont des formes singulières d'intersubjectivité. C'est la relation effective à deux voix, de visages, deux regards complices. Ainsi, l'amour pour être vrai s'extrait du mode précisément religieux et s'incarne dans les individus qui la partagent. La détotalisation n'est pas une désocialisation, elle vise une resocialisation plus réelle, plus horizontale. L'amour est donc cette attention, cette tendresse unique envers l'élu.e. C'est cet amour qui fonde la philosophie, car il implique d'aimer ce qui transcende la vacuité de l'apparent, le vrai.
Dans le geste philosophique d'aimer ou le mouvement qui le signifie est un mouvement vers la vérité, « la vérité de la philosophie se tenant dans la vérité de l'amour ». Les implications théoriques de cette vérité de l'amour et de l’amour de la vérité ne conduisent pas à une équation impossible, mais signale la possibilité, la condition, l'intrigue même de l'amour « comme ce qui la noue irréductiblement à autre chose qu'à elle-même ». Il y a donc un mouvement de décentrement, un mouvement d'intériorisation de l'amour en vue de mieux l'extérioriser. Ainsi, « si la philosophie est amour de la vérité, la vérité de la philosophie se tiendrait plutôt dans la vérité de l’amour. La philosophie serait comme précédée par ce qui en porte la vérité ; elle n’aurait ni le premier, ni le dernier mot sur elle » (p.76).
Dès lors, la politique, la philosophie et l'éthique doivent sortir d'elles-mêmes et se réaliser en leur vérité, car « l'amour force la vérité à sortir de son immobilité, de celle où elle se trouverait depuis toujours en se présupposant elle-même, et que l'automouvement de la pensée chercherait à trouver selon un mouvement nostalgique ».
L’idée d’agir commande ainsi cette relation d’amour, au sens où « éthique et amour partageraient le mouvement d’un débordement, d’une façon de désirer qui n’est pas manque ou besoin, mais l’ouverture qui se produit par ce qui arrive comme excès et qui presse au-delà de soi. Si l’éthique est, selon Levinas, mise en question du soi, l’amour est cette passion, ce pâtir, ce mouvement qui remonte à un en deçà du soi et porte au-delà de soi ». Ainsi, le messianisme favorise la relation éthique « de façon inédite et souvent surprenante », comme l’écrit le professeur Gérard Bensussan. François-David Sebbah souligne à cet effet que « Gérard Bensussan ne méconnait pas ces rapports compliqués entre éthique et amour (…) mais l’emporte pour lui la structure commune à l’éthique et à l’amour » (p.21).
3.2. Le rapport à l’éthique chez Levinas
Le rapport de l’éthique chez le professeur Gérard Bensussan est intimement associé à sa lecture de Levinas, philosophe qu’il cite, commente et dont il clarifie la pensée et les impensées. A la différence de l’éthique fondée ou portée sur l’amour, il précise que « l’éthique de Levinas décrit une sortie, non un interdit. Elle invite à un rapport avec l’inconnu ; elle est un rapport avec un Dehors qu’aucun « dedans » ne peut contenir, nier » (p.182). De même, « devant autrui, il n’y a pas d’espérance : l’avenir est déjà présent ; ou bien, mon présent a déjà été dérobé, de même que le « je » a déjà été porté hors de soi ». Le professeur Gérard Bensussan a déjà formulé la spécificité de sa démarche en ce sens que chacun doit s’apaiser et s’acquiescer avant de tenter le geste d’extériorisation vers autrui. Ethique et expérience porte cette exigence : « Pour répondre d’autrui ou à autrui, ne conviendrait-il pas d’abord que je me prenne en charge, que je m’assume moi-même, à la façon authentique du Dasein heideggérien, pour ensuite me tourner vers les autres[6]».
Concernant l'aspect éthique, c'est une confrontation avec les schèmes lévinassiens qui apparaît. La question de l'amour, que Aïcha Liviana Messina trouve être un concept clé pour penser avec le professeur Gérard Bensussan, se pose ici dans toute son authenticité. Il ne s'agit pas de penser l'amour selon le principe théologique d'une fraternité universelle, mais de donner à travers lui la possibilité d'une réalisation concrète à partir de l'amour tel qu'on l'exprime à une personne qu'on aime en « chair et en os ». On retrouve cette même idée dans le texte de François-David Sebbah qui souligne que chez le professeur Gérard Bensussan, « l’amour comme livraison inconditionnelle de soi à la singularité de l’autre » p.20. En problématisant à partir de Levinas, il note que « l’amour n’est pas l’éthique (au sens de Levinas), et s’oppose même à elle : l’éthique n’est pas réservée aux visages de ceux que j’aime, au contraire tout visage, quel qu’il soit, me l’impose dès lors qu’il fait irruption » p.20. Dès lors, si la structure de l’éthique et de l’amour est commune, la justice reste radicalement différente : « l’amour et la justice sont étrangers l’un à l’autre » d’autant que « la justice n’est pas conditionnée par l’amour ».
Enfin, selon le professeur Gérard Bensussan et contrairement à Levinas, « l’amour précède et excède le droit, le politique, et la politique. Il excède la justice même », car « l’amour tout à la fois suppose – et ouvre – à l’au-delà de l’être : ouverture sans « ré-enveloppement » possible en une fermeture supérieure » (p.21).
Toutefois, note Aïcha Liviana Messina, « Gérard Bensussan met bien en évidence cette façon dont l’éthique intrigue la politique afin de faire celle-ci le lieu d’une traductibilité jamais sans reste de l’éthique, le lieu où passe l’au-delà du politique, le lieu où une langue se dit dans l’autre sans se refermer sur elle-même et sans lequel l’éthique serait inaudible, voire terrifiante » (pp.74-75). Toutefois, dans une humilité qui n’est pas feinte, dans un non-savoir qui s’assume pleinement (pp.141-150), le professeur Gérard Bensussan reconnait sa dette envers Emmanuel Levinas dont certains des concepts permettaient « une méditation sur le désastre du communisme », (p.190). Ce désastre était aussi un désastre politique : « Levinas engageait à séparer le politique de l’étatique en pensant une certaine équivalence entre le politique et le démocratique. Il se tient dans une position de méfiance, relative mais très forte selon moi, devant l’Etat. Levinas m’a permis de mieux saisir, au-delà de son simple constat, la schizoïdie entre l’anti-étatisme marqué de Marx, qui va jusqu’à une pensée antipolitique, et l’étatisme effréné du mouvement communiste, en Union Soviétique, en Chine ». Cette reconnaissance instaure une continuité, à bien des égards, sur plusieurs points sur l’apport global des penseurs juifs à la philosophie occidentale contemporaine[7].
3.3. Traduire l’éthique (en) politique
Traduire l'idéal éthique en désir politique n'est pas si simple qu'il apparaît. L'apparente simplicité ne prend pas en charge la dimension éthique impliquée dans tout agir politique, à rechercher ou à retrouver en lui. C'est cette dimension qui se rapporte à l'inconditionnalité, notion que l'on retrouve chez Derrida au sujet de l'hospitalité. L'inconditionnalité suppose de ne pas faire le calcul du calculable. Hors, il n'y a de politique, que là où il y a un calcul politique. Le sujet de l'immigration le montre suffisamment bien, et le professeur Gérard Bensussan entend lisser les contours de cette pensée inconditionnelle forte telle qu'elle s'exprime chez Derrida.
La traduction de la politique, en tout cas, de ce qui en elle est traductible exige de prendre en compte l'humain dans toute sa complexion. Elle implique à la politique de ne pas être un jeu de stratégie de calcul. D'où vient cette nécessité de traduire la politique, de l'inférer à une certaine démarche éthique?
La politique chez Bensussan est envisagée dans sa double dimension: interindividuelle sans médiation de l'Etat ou des institutions qui le représentent, et étatique. La relation interindividuelle se place sur le plan horizontal et nomme une égalité de reconnaissance. L'ouverture à la différence et le respect de chacun y sont importants. Elle permet de sortir de « l’expérience du vivre ensemble initial (qui) est l’expérience de l’à côté » comme « séparation », menace, ici essentiellement entre les communautés (juive, musulmane, catholique …) : les uns contre les autres, ou le « contre » disant le contact dit déjà l’opposition, l’agressivité sinon l’agression » (p.16). Cette juxtaposition des identités rendue possible par l’absence de mécaniques d’interconnaissance fragilise l’équilibre précaire du vivre ensemble qui peut dégénérer en « violence où viennent se rejoindre la brutalité épidermique des conatus entre eux et la rationalité efficiente, déraisonnable, de l’Etat, dès lors que ce dernier prétend accomplir sans reste la substance des vies humaines » (p.18).
Comment traduire l’éthique en politique ? Comment faire vivre concrètement cette éthique ?
S'agissant de l'Etat, il doit permettre l'expression libre de toutes les sensibilités dans le respect de la loi et des libertés individuelles. Il y a quelque chose de Spinoza, notamment dans la seconde partie du Traité théologico-politique qui définit et précise le rôle des pouvoirs publics.
Enfin, quatre textes partageant les mêmes problématiques autour du temps enrichissent l’ouvrage. Il s’agit des textes de Luc Fraisse, « Levinas interprète de Proust », de Jimmy Sudario Cabral « Dostoïevski, philosophe du nihilisme et messianisme », de Masato Goda « la tâche du traducteur », de Jean-Luc Nancy « Savoir nocturne » qui est une réponse au texte du professeur Gérard Bensussan lui-même « Ne pas savoir qu’on sait ». La richesse des arguments développés dans le volume en fait un livre de premier plan pour saisir les grands événements historiques et idéologiques du XXème siècle et de notre époque.
En somme, cet ouvrage montre que la pensée du professeur Gérard Bensussan invite à sortir du conformisme dans la réception des idées philosophiques. Elle désigne le chemin pour épuiser le concept. C'est donc une pensée riche, dynamique, agile au sens où elle assigne à la philosophie une orientation pratique, au sens kantien du terme. Le savoir ne suffit pas, il faut agir sur le monde, sur l'homme. Le professeur Gérard Bensussan procède par création de concepts, explicitation, et confrontation respectueuse avec les pensées antérieures, un respect qui ne cède pourtant pas à la complaisance. Les lectures de Marx s'inscrivent dans cette dimension, ainsi que celles des pensées que sa recherche embrasse et éclaire d'un jour nouveau. Le génie du philosophe se reconnaît aussi par les liens féconds qu'il introduit entre la philosophie et la pensée juive, une pensée vive, émancipatrice. Il arrive à concilier philosophie et judaïsme, à partir de leur but émancipateur commun. Si le judaïsme n'est pas étranger à la chose philosophique, si celle-ci a toujours été en creux en celui-là, c'est parce que comme religion et comme discours, le judaïsme porte les problématiques humaines, de la découverte de soi, du développement plénier de son potentiel. La façon dont le professeur Gérard Bensussan interprète le messianisme engage elle aussi à reconnaître cette vivacité du penser en milieu juif, cette attente de ce qui doit arriver n'empêchant pas chacun de tendre au raffinement intellectuel, social, politique et éthique, bref à sa réalisation humaine.
L’intérêt philosophique d’étudier la politique consiste aussi à en cerner les marges, ce qui n’apparaît pas directement comme production médiatisée de la politique. Comment saisir ce qui peut être la conséquence d’une certaine politique, d’une certaine manière de faire la politique ? La question n’est pas elle-même politique, puisqu’elle excède la politique et ouvre vers ce qui reste. Chez le professeur Gérard Bensussan, le geste philosophique de sortie de la politique vers la philosophie réengage à saisir les marges de la politique et celles de la philosophie dans un même geste. Ainsi, Ostalgérie exprime ces restes qui résistent à la perte, qui inscrivent leur trace dans la mémoire et en facilite le processus de mémoration. La lecture de Hegel invite ainsi à une pensée médiane pour la saisir et la sortie de ses limites propres, le judaïsme constitue en ce sens une clé pour comprendre Hegel en vue d’en sortir, de s’extraire de l’emprise de son système.
Enfin, « penser » avec le professeur Gérard Bensussan, c’est cerner le sens de ce que veut dire penser, c’est-à-dire penser au sens heideggérien les ruptures dans et de la pensée, les points sur lesquels il est intenable de construire un discours philosophique. Sur ce terrain, la lecture rigoureuse des pensées donnée dans ces différents ouvrages impulse une nouvelle direction, celle de sortir des conformismes dans l’accueil des pensées en vue de dessiner des sillons féconds dans l’histoire de la philosophie par l’entrain des concepts. Il s’agit, par exemple, de ne pas se laisser jouer par l’apparente simplicité de ce qui se ploie à notre observation sur la/le politique. Définir la politique, c’est s’inscrire dans une évaluation attentionnée entre le dire et le faire, entre le conditionné de la loi et l’inconditionnel de la justice, justice qui caractérise pour la politique son point d’assomption, de concrétude. La pensée développée dans l’œuvre du professeur Gérard Bensussan esquisse ainsi une nouvelle manière de penser, en partant de l’expérience concrète d’un individu placé dans ce que Rosenzweig appelle la « symphonie polyphonique de l’humanité ».
[1] Gérard Bensussan, Le temps messianique : temps historique et temps vécu, Paris, Vrin, 2001
[2] Ibid., p.110.
[3] Ibid., p.10.
[4] Franz Rosenzweig, L’étoile de la rédemption, Paris, Seuil, 2003, p.465.
[5] Ibid., p.112.
[6] Gérard Bensussan, Éthique et expérience. Lévinas politique, Strasbourg, la Phocide, 2008, p. 17.
[7] Gérard Bensussan, Qu’est-ce que la philosophie juive, Paris, Desclée de Brouwer, 2003, p.189 : les penseurs juifs qui ont « le plus contribué à réinventer la langue philosophique du français, à en féconder le style, à l'accoucher de concepts majeurs. »
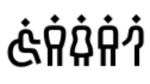
Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés